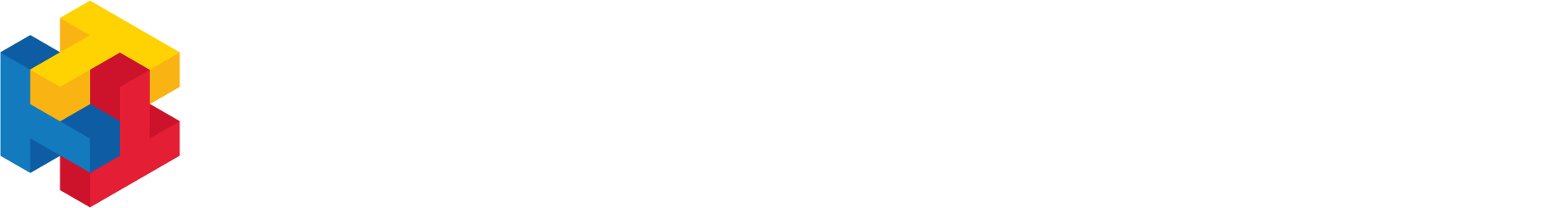Toute activité humaine est source de pollution. Or le numérique est une activité humaine. Donc le numérique pollue.
Si nous étions tous sophistes, cet article n’aurait peut-être pas lieu d’être. Seulement dans l’imaginaire collectif, la pollution reste avant tout associée à des fumées toxiques, à des déchets radioactifs, à des marées noires ou plus récemment à des océans de plastique. Tout ce qu’il y a, somme toute, de plus tangible, de plus visible.
À l’inverse, le numérique c’est la promesse de la disponibilité et de l’immédiateté. C’est pouvoir s’informer, discuter et acheter de tout, n’importe où et n’importe quand. Dans le métro, au boulot, ou avant dodo, le numérique est partout à la fois. Si bien qu’on ne le voit plus. Et puisqu’on ne le voit plus, on l’oublie.
On oublie d’où viennent nos appareils. On oublie aussi ce qu’ils deviennent une fois qu’on en a fini avec eux. Et entre les deux on oublie tout ce qui se cache derrière nos écrans. Il n’y a ni pot d’échappement ni de bruyants réacteurs à l’arrière de nos téléphones. Pour autant, en 2020 le numérique émet 4% des gaz à effet de serre du monde*. 4% cela semble peu, mais en ordre de grandeur c’est déjà 2 fois plus que le transport aérien civil. Et d’ici 2025, ce pourcentage pourrait doubler et dépasser celui des émissions de voitures. Et les émissions de gaz à effet de serre (GES) ne sont jamais qu’un type de pollution parmi d’autres…
Alors comment expliquer la pollution engendrée par le numérique ?
“Je ne crois que ce que je vois” disait Saint Thomas. Seulement au 1er siècle ap. J.-C., les technologies du numérique n’existaient pas. Penser que nos usages virtuels sont immatériels est un raccourci tentant, mais trompeur. Il faut moins d’une seconde pour télécharger une image vers son Drive, hébergé sur le cloud. Ce que l’on ne voit pas quand cette image quitte notre ordinateur, c’est qu’elle passe par notre box, puis voyage à travers des centaines de milliers de kilomètres de câbles, est stockée sur plusieurs serveurs dans le monde, et fait le chemin inverse à chaque fois que l’on souhaite y accéder. Et il en va de même pour nos mails, nos likes, etc.
Que cela soit visible ou non pour l’utilisateur, le numérique repose sur des infrastructures colossales. Des infrastructures gourmandes en énergie, connectées à des milliards de terminaux électroniques partout dans le monde, eux-mêmes gourmands en énergie, et dont il faut gérer la production, l’acheminement, l’utilisation, puis la fin de vie. Le numérique est donc loin d’être immatériel. À vrai dire, moins sa matérialité est apparente, plus cela implique qu’elle a été déplacée ailleurs. Le terme même du cloud, tel un nuage insaisissable, en est un bon exemple. C’est quelque part ce cercle vicieux qui nous pousse à facilement oublier ses effets en termes de pollution… qui elle ne cesse pourtant de s’accentuer.
En effet, l’offre croissante en termes de services et d’équipements numériques reflète et nourrit la demande. Plus nos usages numériques s’accélèrent, plus on récupère également des données qu’il faut stocker et traiter… en construisant ainsi de nouvelles infrastructures. Ce qui renforce à son tour les besoins en énergie, de même que, en bout de course, la production de nouveaux déchets. Or 70 % des déchets électroniques mondiaux faisant l’objet d’un trafic, les conséquences environnementales et sociétales de leur “recyclage” sont difficiles à évaluer, celui-ci étant aujourd’hui de toute façon complexe, coûteux et globalement inefficace.
Quelles sont les principales sources de pollution du numérique ?
D’après un rapport de l’institut du GreenIT** de 2019, les premières sources d’impacts environnementaux du numérique sont par ordre décroissant :
- La fabrication des équipements utilisateurs ;
- La consommation électrique des équipements utilisateurs ;
- La consommation électrique du réseau ;
- La consommation électrique des centres informatiques ;
- La fabrication des équipements réseau ;
- La fabrication des équipements hébergés par les centres informatiques (serveurs, etc.)
Là encore, cette hiérarchie peut sembler contre-intuitive. On pourrait légitimement penser que les centres informatiques (les datacenters) comme les infrastructures réseaux (les box, les câbles, les antennes), de par leur taille et leur expansion sur le territoire, pèseraient davantage dans la balance que nos petits téléphones de poche. C’est pourtant faux, et principalement lié à une question d’échelle. On compte plus de 34 milliards d’équipements numériques à travers le monde, contre 67 millions de serveurs. Ces équipements ne se limitent pas à nos téléphones et à nos ordinateurs, mais comprennent également les imprimantes, les écrans, et les 15 milliards autres objets connectés dont le nombre sera logiquement multiplié dans les années à venir, notamment lié au déploiement de la 5G.
Mais il n’y a pas que la notion d’échelle qui explique le poids que représente nos équipements utilisateurs. Là où un serveur peut être construit pour répondre à des usages précis et pour durer dans le temps (maintenance, réparabilité), nos équipements visent eux un marché de masse, intègrent de nombreuses fonctionnalités inutilisées, et ne sont tout simplement pas conçus pour durer (obsolescence matérielle comme psychologique). Or les manquements liés à cette phase de conception, eux non plus, ne sont pas visibles à l’œil nu.
Dès lors, c’est de loin la fabrication de ces milliards d’appareils qui génère les plus gros impacts en termes de pollution. Il n’y a d’ailleurs pas que les émissions de GES, mais aussi l’épuisement des ressources (eau douce, métaux), la pollution des sols, des rivières etc. Un téléphone neuf qui sort du magasin a déjà consommé, pour ainsi dire, les trois quarts environ de son empreinte environnementale. Cela provient des tonnes d’eau et de terres qu’il a fallu extraire et mobiliser dans sa phase de production (plus de 50 matières premières différentes pour un seul smartphone), et de toutes les énergies fossiles nécessaires pour la rendre possible. Ce “sac à dos écologique” n’est jamais visible au moment de l’achat, mais il pèse pourtant très lourd. Encore une fois, sa matérialité a simplement été déplacée, cette fois-ci loin de nos villes occidentales dans les mines et les usines d’Asie, d’Afrique, ou d’Amérique Latine.
Le numérique pollue, oui et alors ?
Après tout, toute industrie pollue. Et les comparaisons que l’on peut faire entre elles à cet égard rencontrent inévitablement certaines limites. Comment opposer le numérique et le transport aérien quand les besoins sous-jacents auxquels ils répondent sont fondamentalement différents ? Et comment opposer les 4 milliards de passagers qui empruntent le transport aérien par an avec les milliards d’utilisateurs qui se connectent chaque jour ? Plus délicat encore, comment opposer les indéniables bienfaits et progrès permis par les nouvelles technologies avec ses non moins indéniables limites et effets ?
Dès lors, le débat ne peut être manichéen. Autrement dit, ça n’est pas parce que le numérique pollue qu’il faut le remettre en cause. Que cela ne nous empêche pas, en revanche, de le questionner. Questionner nos usages, et donc avant tout nos besoins. Si on prend l’exemple de la 5G, cela revient non pas à articuler un débat “pour ou contre”, mais plutôt à poser la question du pourquoi et à quelles fins. De même, les injonctions invitant à “supprimer ses mails”, à “regarder moins de vidéos HD” ou à “éteindre sa box” -pourtant légitimes- sont trop réductrices, trop superficielles et sûrement trop limitantes pour qu’elle puissent convaincre et inciter à l’action. De tels changements comportementaux, pour qu’ils soient durables, impliquent de remonter sensiblement dans l’échelle de nos besoins et appellent dès lors un changement de paradigme, au sens de vision du monde. Au risque sinon de traiter en vain les symptômes en lieu et place de ce qui les cause.
S’il faut donc rappeler encore et encore que le numérique pollue, c’est que cette vérité qui nous dérange est encore loin d’être acquise, tout simplement. Le numérique se diffuse de manière si rapide et si transverse dans nos quotidiens qu’il en devient une sorte d’évidence dont on ne questionne plus ni l’origine ni les impacts. Et puisqu’on n’en parle pas, alors on oublie. D’où la nécessité pour toute organisation publique ou privée d’entamer ou de poursuivre la sensibilisation à ces enjeux. Comme pour tout plan de conduite du changement, cela implique d’agir sur les leviers de la formation et de la communication. De l’école primaire à celui de la formation professionnelle, en passant par les médias, le spectre est large mais à la hauteur des enjeux. Non pas que cela suffise bien sûr, car encore faut-il en parallèle renforcer la législation dans le domaine, investir dans de nouvelles filières etc. Mais en attendant, seul un travail de pédagogie, et donc de répétition, permettront de rendre visible le non-visible… jusqu’à faire du numérique responsable et de ses usages raisonnés la prochaine évidence aux yeux du plus grand nombre.
Quelques lectures pour aller plus loin :
- L’Enfer numérique : Voyage au bout d’un like, Guillaume Pitron (Les Liens qui Libèrent)
- Vers un numérique responsable, Repensons notre dépendance aux technologies digitales, Vincent Courboulay (Actes Sud)
*Rapport Pour une sobriété numérique du Shift Project (octobre 2018)
**GreenIT (rapport 2019, Frédéric Bordage). À noter que la fin de vie des équipements n’a pas été prise en considération car aucun facteur d’impact fiable n’existe à l’échelle internationale.